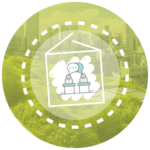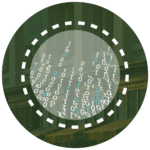25 ème congrès
Réussir la transition vers une économie zéro carbone
Commission 1 « THE POLICY TOOLBOX »
Sous la direction d’Estelle Cantillon (ULB)
- Scénarios d’investissement à l’horizon 2050 : une approche multi-systèmes qui intègre les options de sobriété est requise - Emily Taylor (SPF Santé publique) et Vincent van Steenberghe (UCLouvain)
- Interactions between climate policy instruments- Marten Ovaere (UGent)
- The Impact Assessmentmethodology of the European Commission and the transition towards a zero-carboneconomy in Belgium - Jean-Pierre De Laet (ULB)
- Analyse ex-ante des politiques publiques : Leçons des tranchées - Baudouin Regout (Bureau Fédéral du Plan)
Commission 2 « MANAGING TRANSITION COSTS »
Sous la direction d’Axel Gautier (ULiège)
- Financing green technologies:Lessonsfromgeneroussubsidy programs in Belgium - Olivier De Groote (University of Toulouse Capitole), Axel Gautier (University of Liège) & Frank Verboven (KU Leuven)
- Le dilemme du tarif social de l’énergie - Axel Gautier (ULiège) et Pierre Pestieau, (ULiège)
- Transition énergétique : un déni de la réalité et de la complexité ? - Philippe Defeyt (Institut pour un Développement Durable)
- Transition énergétique et participation citoyenne : le cas des communautés d’énergie - Remy Balegamire Baraka (ULiège), Thomas Bauwens (Erasmus University) & Stéphane Monfils (ULiège)
Commission 3 « DATA AND DATA INFRASTRUCTURE »
Sous la direction de Sébastien Brunet (IWEPS)
- Prendre la mesure de la transition juste - Éloi Laurent (OFCE/Sciences Po, Ponts Paristech, Stanford University)
- Indicateurs de suivi des SDG pour la Belgique - Alain Henry (Bureau Fédéral du Plan)
- La transition juste : un défi pour les statistiques wallonnes - SíleO’Dorchai (IWEPS & ULB)
- Les nouvelles données de la transition énergétique - Estelle Cantillon (ULB) et Elise Viadere (ULB)
Commission 4 « FIRMS AND THE CLIMATE TRANSITION »
Sous la direction de Frank Venmans (London School of Economics)
- Low carbon scenarios for Belgium: insights from a tri-regionalenergy system model - Léo Coppens (UMons)
- Solar and windonly cannibalise prices if you let them. Impact of carbonpricing and renewables support on power prices - Dominic Scott (Regulatory Assistance Project) & Bram Claeys (Regulatory Assistance Project)
- The Role of Managerial Practices in the Transition Towards Net Zero - Laure de Preux (Imperial College London)
- Prix énergétiques, taxe carbone et emploi - Bruno Van der Linden (UCLouvain)
- The Impact of Climate Change and Climate Policies on Productivity - Gert Bijnens (National Bank of Belgium)
Commission 5 « FUNDING THE TRANSITION »
Sous la direction de Mirabelle Muûls (Imperial College London)
- Quel policy mix pour une transition climatiquejuste et efficiente? - Christian Valenduc (UCLouvain)
- Sustainable Finance in Belgium: Navigating Challenges, Seizing Opportunities, and Innovating for the Future - Constance d’Aspremont (Greenomy)
- Asset overhang and the green transition - Hans Degryse (KU Leuven), Tarik Roukny (KU Leuven) & Joris Tielens (National Bank of Belgium)
- Addressing barriers to energy efficiency investment: the case of SMEs in Belgium - Olivier Debande (European Investment Bank & ECARES)
- Making real estate more sustainable: in search of a business case - Antoon Soete (Wattson)
Commission 6 « CLIMATE ACTION AND THE WORLD »
Sous la direction de Johan Eyckmans (KU Leuven)
- Geopolitics:Friend or foe of Climate Action? - Adel El Gammal (European Energy Research Alliance)
- EU climate and energy policy developments to a climate-neutral world and the role of hydrogen - Carla Benauges (EU Commission, DG Clima)
- CircularEconomy's Potential to Satisfy the EU's Critical Metals Demand for Green Transition - Karel Van Acker (KU Leuven) & Johan Eyckmans (KU Leuven)